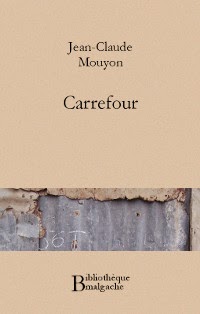Après avoir tracé une longue diagonale du sud-ouest au
nord-est de Madagascar, je m’étais posé quelques jours, au début du mois
d’août, dans une ville côtière plus célèbre pour la vanille qui s’y produit que
pour sa participation aux événements de 1947. La vision quotidienne, près du
port, d’une stèle en hommage aux martyrs de cette révolte, me renvoyait sans
cesse au premier roman d’Aurélie Champagne, Zébu Boy, ancré dans un moment d’Histoire dont les protagonistes n’ont pas gardé
le même souvenir.
A Madagascar, le 29 mars, date en 1947 des premiers
affrontements contre les colons et, dans la foulée, du début d’une sévère
répression, est aujourd’hui encore un jour férié pendant lequel la vente
d’alcool, comme lors des élections, est interdite et l’occasion de cérémonies
commémoratives dont le centre est plus souvent à Moramanga, dans l’est, qu’à
Antananarivo, la capitale où l’on ne manque cependant jamais de se souvenir.
En France, rien ne signale dans le calendrier ce qui semble
avoir été un lointain soubresaut de l’épopée coloniale au moment où le prestige
de celle-ci vacillait. Jacques Chirac, lors d’une visite officielle à
Madagascar en 2005, avait néanmoins évoqué cette page sombre dans les relations
entre les deux pays et dénoncé, sans s’attarder sur les détails, « caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du
système colonial ».
L’acte de contrition avait été fait, cependant, en d’étranges circonstances. Le
lieu, d’abord, s’y prêtait mal, d’une part parce que Mahajanga, sur la côte
ouest, se situe bien loin des régions où les combats avaient eu lieu, d’autre
part parce que cette même ville avait été, en 1895, le théâtre du débarquement
des troupes françaises qui entamaient la « conquête » de l’île.
Ensuite, le président malgache Marc Ravalomanana avait évacué la question en
rappelant qu’il n’était pas né en 1947…
Des historiens
malgaches et français ont néanmoins, et très rapidement après les événements,
abordé le sujet – qui reste d’ailleurs polémique. Si des écrivains malgaches,
au premier rang desquels Raharimanana, en faisaient un des moments fondateurs
de leur imaginaire, la littérature française y a peu puisé. En 1995, Patrick Cauvin
avait publié Villa Vanille, un roman pétri de bonnes intentions mais qui
passait à côté du sujet. Plus récemment, en 2012, Pierre d’Ovidio avait envoyé,
pour la deuxième enquête d’une série de « grand détective »,
l’inspecteur Maurice Clavault à Madagascar au moment où éclataient les troubles
de 1947. Ce n’était guère plus convaincant.
Aurélie Champagne,
dans son premier roman, choisit un Malgache comme personnage central. Ambila a
été rapatrié après avoir combattu dans la Meuse et avoir été capturé par les
Allemands. Depuis six mois qu’il est rentré, il ne supporte plus d’être
redevenu « le pauvre indigène qu’il était avant guerre ». Il n’est
même plus vraiment le Zébu Boy dont la réputation s’était construite sur son
habileté à renverser les bœufs lors des savika, les combats
traditionnels. Il est prêt à sauter sur la première occasion d’occuper la place
qu’il mérite dans la société. Et, précisément, sa route l’entraîne vers
Moramanga au moment où éclate la rébellion.
La biographie
fournie par votre éditeur signale un séjour de six mois à Madagascar en 1998.
Etait-ce la toute première fois ? Et y partiez-vous dans un but
précis ?
A 20 ans, après
deux intenses années de classe préparatoire, j’ai eu envie de prendre le large
et de sortir de mes livres. J’ai économisé et me suis offert un aller-retour à
Madagascar. A l’époque, il n’y avait pour moi aucune autre terre à fouler. Je
porte un double nom : Champagne-Razafindrakoto et je n’avais jusque-là
aucune image, ni aucun vécu à mettre derrière ce nom malgache, hormis de vagues
histoires d’orphelinat, de Reine et de privation. La mythologie familiale, chez
moi, racontait en outre que ce nom de « Razafindrakoto » signifiait
« Fils de Prince » et laissait entendre que nous avions peut-être des
ascendants royaux. Autant dire que la première personne à Madagascar à qui j’ai
raconté cette histoire a éclaté de rire. D’une certaine manière, ma quête des
origines s’est arrêtée net ce jour-là, en apprenant que le nom que je portais
équivalait plutôt à « Dupont » ou « Durand ». Ca a
laissé de la place pour le reste, et alors c’est le pays, dans toute sa
splendeur qui m’a saisie.
A quel moment avez-vous
commencé à vous intéresser à l’insurrection de 1947 ? L’idée d’un roman
dans ce contexte a-t-elle germé rapidement ? Ces événements avaient-ils
une raison particulière de vous toucher ?
Je gardais un
souvenir refroidi de l’insurrection de 1947. A peine une ligne dans un manuel
d’histoire de classe de terminale. Or, à Madagascar, j’ai eu la chance de faire
un petit bout de chemin avec un universitaire qui m’a raconté les Tabataba.
Nous étions en 1998, au lendemain du cinquantenaire. J’ai découvert à quel
point cette mémoire était vivante. A quel point elle battait encore au sein de
certaines familles.
Le livre repose
sur des documents écrits, et vous fournissez d’ailleurs un embryon de bibliographie. Avez-vous utilisé
aussi des témoignages oraux ?
Zébu Boy
s’appuie sur un travail de documentation mais il est avant tout un roman avec
un héros fictionnel. Ce n’est pas un livre d’histoire. Seulement, pour raconter
la destinée romanesque d’un ancien des combats de France, rentré au pays et
presque aussitôt happé par les événements, j’avais besoin de documenter le
contexte historique. J’ai donc lu au fil des années toutes sortes de documents,
sans vraiment me préoccuper de méthodologie. Je lisais tout ce que je
trouvais : thèse, actes de colloques, témoignages, notes issues des
Archives nationales d’Outre-mer à Aix, et autres sources primaires,
documentaires, fictions, journaux de missionnaires ou de colons issus de
l’administration… Le plus souvent, une lecture soulevait plusieurs questions,
pour lesquelles j’allais chercher des réponses dans d’autres lectures. D’autres
avant moi ont eu à cœur de collecter des témoignages oraux et l’ont fait
merveilleusement : de l’auteur Jean-Luc Raharimanana à la documentariste
Marie-Clémence Paes avec son récent Fahavalo, en passant
évidemment par les historiens Faranirina Rajaonah ou Jean Fremigacci, pour ne
citer qu’eux. Ces deux derniers m’ont d’ailleurs fait l’amitié de relire le
roman, et de formuler des observations qui, recoupées avec celles de Françoise
Raison, Martin Mourre et Jean-Noël Gueunier, ont été très précieuses pour le
texte.
Si l’on comprend
bien, Zébu Boy est la troisième
version de ce livre. N’avez-vous pas eu envie de passer à autre chose ou bien
le thème vous habitait-il au point qu’il était nécessaire de mener ce projet à
son terme, c’est-à-dire jusqu’à la publication ?
Disons qu’il m’a
fallu écrire plusieurs histoires pour trouver celle que j’avais réellement
envie de raconter. L’intrigue s’est d’abord formulée le temps d’une nouvelle,
inspirée d’une anecdote trouvée dans la thèse de Jacques Tronchon. Puis la
narration s’est déployée sur quatre générations, de l’immédiat après-guerre au
tournant des années 2000. Avant de se recentrer à nouveau sur 1947. Au fil des
allers et retours, je me suis découragée plusieurs fois et j’ai eu
effectivement envie de passer à autre chose. C’est même ce que j’ai fait :
mon activité de scénariste notamment m’a donné à plusieurs reprises
l’occasion d’aller me dégourdir les méninges dans d’autres univers. Mais je
suis toujours revenue à 1947.
Votre personnage
principal s’appelle Razafindrakoto. On suppose que ce n’est pas par hasard…
Effectivement.
Razafindrakoto est en effet un clin d’œil à ma grand-mère malgache. Mais il
suffit de consulter des archives du ministère de l’armée et sa base « mémoire
des hommes » par exemple, pour croiser des dizaines de Razafindrakoto
morts au combat ou des suites de maladie, pendant la seconde guerre mondiale.
Au fond, il n’est
pas très sympathique. Pilleur de cadavres, avec toujours en tête un mauvais
coup à jouer à son compagnon d’aventures, c’est un opportuniste embarqué dans
l’action un peu par hasard. Ou bien on se trompe ?
Zébu Boy est un
combattant hors pair, que la vie a
exposé à toutes sortes d’épreuves. Il les a toutes surmontées. Quand l’histoire
commence, le héros continue à faire ce qu’il sait faire : survivre. Il
épouse effectivement l’insurrection par opportunisme, plus que par idéologie
et, chemin faisant, découvre ou croit découvrir sa véritable vocation.
Une anecdote en dit
long sur les raisons (multiples) que peuvent avoir les Malgaches, en rentrant
de la Seconde Guerre mondiale, d’en vouloir à leurs colonisateurs :
ceux-ci reprennent leurs chaussures au retour. Elle est authentique ?
L’anecdote est
authentique, oui. En juillet 1946, l’armée française a démobilisé 6000
Malgaches et Réunionnais. La guerre était finie depuis plus d’un an. Ces
soldats comptaient parmi les derniers à rentrer. Beaucoup étaient restés dans
des camps de transition, où les conditions de vie étaient déplorables,
attendant pendant des mois un bateau pour les transporter. Quand ils sont enfin
arrivés à Toamasina en août 1946, l’intendance militaire leur a retiré leurs
chaussures pour reconstituer les réserves. Ce geste a été vécu comme une
véritable humiliation.
Aviez-vous une
intention particulière en parlant de cette époque, et de cette manière ?
Je
crois qu’on parle souvent des révolutions avec un grand R : elles
deviennent presque des abstractions, des concepts. Ce qui m’a d’abord fasciné a
été la mécanique historique des événements de 1947. Mais au fil des années, le
vécu des anciens combattants de métropole s’est éclairé. De même, la découverte
de leur parcours au sein des frontstalags et leur retour dans l’île a contribué
à ramener l’insurrection au sol. J’ai eu envie d’essayer de raconter les
événements à hauteur d’homme, dans leur incarnation la plus prosaïque.